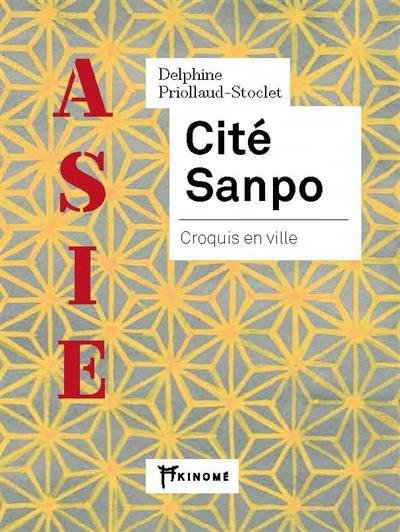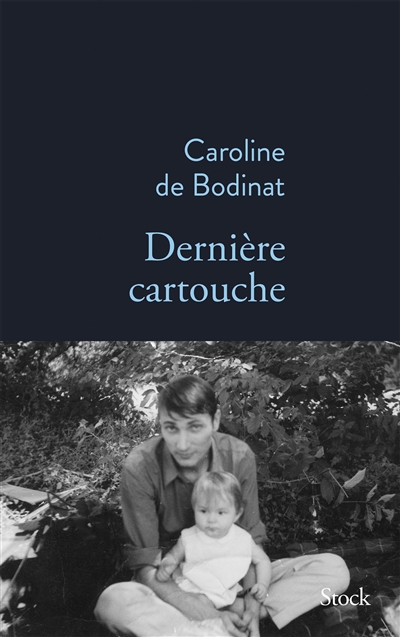Lu en format numérique
Nous sommes à Kamakura, en périphérie de Tokyo. Poppo est une jeune femme très investie dans son métier. Suivant les traces de sa grand-mère, elle a repris le commerce familial qu’est la papeterie Tsubaki du titre. Bien plus qu’une papeterie, Poppo y exerce là le métier d’écrivain public, fonction transmise par son aïeule, l’Aînée, avec la plus grande rigueur. C’est avec donc énormément de soin qu’elle s’occupe de ses clients, écoutant leur requête, réfléchissant à la meilleure manière de de transmettre un message qu’il soit heureux ou triste. Une fois la missive arrêtée, elle s’attache à choisir stylo et papier qui correspondront parfaitement à l’objet du message. C’est un travail de fourmi car il ne s’agit pas seulement de « répondre à la place des autres » mais bien de s’imprégner des éléments d’une vie pour véhiculer les bonnes informations.
Quand je commençais à manquer d’argent, je réalisais souvent des calligraphies pour les étrangers fascinés par les kanji et le japonais. A l’époque, c’était le boom de la culture asiatique. Les jeunes arboraient fièrement des tee-shirts portant des inscriptions en kanji ou s’en faisaient tatouer sur la peau, c’était à la mode. Mais dans la plupart des cas, soit il y avait des fautes, soit c’étaient des formules risibles bien que correctes.
Par exemple, avec un petit trait en trop, le mot « samouraï » se transformait en verbe « attendre », c’était fréquent. On voyait aussi des jeunes filles se promener impassibles, avec un tee-shirt marqué « gratuit » sur la poitrine – sans doute croyaient-elles proclamer leur « liberté » en japonais. Les kanji étaient rarement employés à bon escient. (pp. 41-42)
En Chine, les kanji du mot « lettre » désignent le papier hygiénique. Ce qu’il venait de me demander, ce n’était pas une lettre, mais du PQ. J’avais la désagréable impression qu’il me confiait la tâche de lui torcher le derrière. (p. 67)
Avoir peur des pigeons alors que je porte leur nom, voilà qui est bizarre, me direz-vous, mais je n’ai jamais trouvé ces oiseaux sympathiques. (p. 107)
(Petit aparté : je ne m’appelle pas Poppo mais je déteste tout autant les pigeons)
J’aime la linguistique et, depuis que j’apprends le japonais, je suis très sensible aux proximités et différences avec les autres langues (notamment le chinois à qui il emprunte les kanji). Ce sont donc surtout des passages qui font la part belle aux langues que j’ai relevés.
Ce livre est avant tout un roman d’ambiance. Ne vous attendez pas à un/des élément(s) perturbateur(s) car c’est un quotidien qui se donne à voir, la vie d’un lieu – ou plutôt d’une profession. C’est à la fois délicat et sensible car Poppo met tant de cœur à l’ouvrage qu’on s’y laisse prendre également. Je regretterais juste, du fait de ma lecture numérique, que les lettres rédigées par Poppo (jointes au texte), aient été si petites et donc illisibles. Je me suis ensuite procurée le livre papier et les lettres sont en fait tout à fait au format (et donc lisibles). Cela aurait apporté encore plus de grâce à cette lecture déjà fort plaisante !
La papeterie Tsubaki / Ogawa Ito ; traduit par Myriam Dartois-Ako
(Éditions Philippe Picquier, 2018, 163 p.)